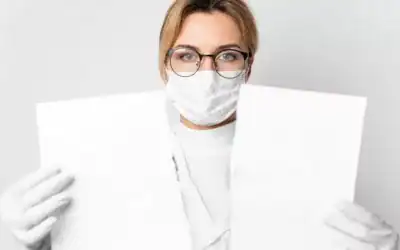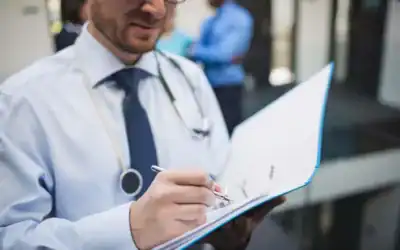La procédure disciplinaire des professionnels de santé
Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues … Nombreux sont les professionnels de santé soumis à un régime disciplinaire spécifique, encadré par leur ordre professionnel. Cette procédure, méconnue du grand public comme des praticiens eux-mêmes, obéit à des règles précises, protectrices tant pour le plaignant que pour le professionnel mis en cause.
Dans cet article, le cabinet Carlini & Associés, reconnu pour son expertise en droit de la santé, vous éclaire sur les grandes étapes de cette procédure et ses enjeux.
Le fondement de la procédure disciplinaire
Les professionnels de santé sont tenus de respecter les règles déontologiques propres à leur profession, issues notamment du Code de la santé publique et des codes de déontologie élaborés par les ordres professionnels.
En cas de manquement aux devoirs professionnels (atteinte à l’honneur, non-respect de l’indépendance, manquement au devoir de probité, violation du secret médical, comportement inapproprié…), une procédure disciplinaire peut être engagée. Son objectif n’est pas d’indemniser un patient, mais de sanctionner un comportement contraire à l’éthique professionnelle.
La juridiction disciplinaire ordinale, distincte des juridictions civiles ou pénales, est compétente pour juger ce type de contentieux.
Qui peut déposer une plainte disciplinaire ?
Contrairement à une idée reçue, la plainte ne peut être introduite uniquement par un patient. Plusieurs acteurs ont qualité pour agir :
1. Les instances ordinales et les assurés sociaux
- Le Conseil départemental ou national de l’ordre compétent ;
- Les caisses d’assurance maladie, via les médecins-conseils ;
- Les associations de défense des patients ;
- Un syndicat professionnel.
2. Les autorités publiques
- Le ministre de la Santé, le préfet, le directeur de l’ARS, ou encore le procureur de la République peuvent aussi agir, notamment lorsque le professionnel exerce une fonction de service public.
La plainte est recevable même si le praticien n’est plus inscrit au tableau de l’ordre à la date de la plainte, dès lors qu’il l’était au moment des faits.
Le formalisme de la plainte
Pour être recevable, la plainte doit :
- Être adressée par écrit, de préférence en lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Détailler les faits reprochés ;
- Mentionner, dans la mesure du possible, les articles du code de déontologie potentiellement enfreints.
Une notification formelle est ensuite transmise au professionnel mis en cause, qui peut préparer sa défense, avec ou sans l’assistance d’un avocat.
La procédure en deux phases : conciliation puis contentieux
A. La tentative de conciliation
Lorsque la plainte ne provient pas d’une autorité ou d’un syndicat, le Conseil départemental de l’ordre organise une tentative obligatoire de conciliation, dans un délai d’un mois. Cette étape vise à désamorcer les conflits sans recours juridictionnel.
Le praticien peut se faire accompagner par un avocat, un confrère inscrit à l’ordre, ou les deux. À l’issue, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est dressé.
B. La saisine de la juridiction ordinale
En cas d’échec de la conciliation, le dossier est transmis à la chambre disciplinaire de première instance (CDPI), avec un avis motivé. C’est à cette juridiction que revient la charge de statuer sur la réalité de la faute déontologique.
La chambre disciplinaire de première instance
Une fois saisie, la CDPI :
- Instruit le dossier : un rapporteur est désigné pour mener les auditions et recueillir les pièces ;
- Fixe une audience publique, sauf huis clos décidé dans l’intérêt de l’ordre public, de la vie privée ou du secret médical ;
- Statue dans un délai de six mois, en respectant le principe du contradictoire.
Le praticien peut produire un mémoire en défense, déposer des pièces justificatives (certificats, témoignages, éléments médicaux) et demander à être entendu à l’audience.
La décision est prise à la majorité des membres, avec voix prépondérante du président en cas d’égalité. Elle est rendue publique par voie d’affichage.
La chambre disciplinaire nationale : l’appel
En cas de condamnation, le professionnel dispose de 30 jours pour interjeter appel devant la chambre disciplinaire nationale, juridiction d’appel présidée par un conseiller d’État.
Cette juridiction est indépendante de l’ordre local et offre un réexamen complet de l’affaire. L’appel est suspensif : la sanction initiale est suspendue jusqu’à décision définitive.
Le Conseil d’État : le pourvoi en cassation
La décision de la chambre disciplinaire nationale peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État, dans un délai de deux mois.
Ce recours est fondé exclusivement sur des moyens de droit (irrégularité de la procédure, violation de la loi, excès de pouvoir…) et n’est pas suspensif, sauf décision contraire ou demande expresse.
Les sanctions encourues
Les sanctions disciplinaires varient selon la gravité des faits :
- Avertissement ou blâme ;
- Interdiction temporaire d’exercice, avec ou sans sursis, pouvant aller jusqu’à trois ans ;
- Radiation du tableau de l’ordre, entraînant une interdiction d’exercer sur tout le territoire.
En cas d’insuffisance professionnelle, une formation obligatoire peut être imposée.
La loi ne prévoit aucun délai de prescription : une procédure peut être engagée à tout moment, tant que le professionnel est en vie.
Suspension d’office et mesures d’urgence
En cas de danger grave pour les patients ou d’urgence avérée, le préfet peut suspendre temporairement l’exercice d’un professionnel. L’ordre est ensuite saisi et dispose de quatre mois pour statuer.
Une suspension peut également être décidée en cas :
- D’infirmité ou état pathologique incompatible avec l’exercice ;
- D’insuffisance professionnelle caractérisée.
En résumé : que faire en cas de plainte ou de convocation ?
La procédure disciplinaire des professionnels de santé est rigoureuse, à la fois protectrice des droits du praticien et garante de l’éthique médicale. Elle suppose une parfaite maîtrise des règles procédurales et des textes applicables.
Vous êtes mis en cause devant une chambre disciplinaire ? Vous souhaitez défendre vos droits, anticiper les risques ou vous faire accompagner dès le dépôt d’une plainte ? Le cabinet Carlini & Associés vous assiste à chaque étape de la procédure, dans le respect de votre secret professionnel et de vos intérêts.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour un rendez-vous confidentiel.
LES AUTRES ARTICLES
Maladie professionnelle et secret médical : les limites du secret médical
Le principe du secret médical dans le cadre de la maladie professionnelle Le secret médical constitue un pilier de notre système de santé. Il protège toutes les informations relatives à l’état de santé d’une personne. En matière de maladie professionnelle, ce secret...
Le déroulement des opérations d’expertise médicale
L’expertise médicale occupe une place centrale dans le règlement des litiges liés aux accidents médicaux, aux erreurs de soins ou aux préjudices corporels. Véritable mesure d’instruction, elle vise à éclairer les parties et, le cas échéant, le juge, sur les causes...
L’obligation du professionnel de santé de tenir un dossier médical complet
Le dossier médical : un outil fondamental au cœur de la relation de soins Le dossier médical constitue bien plus qu’un simple recueil d’informations : il est l’outil central de la coordination, de la traçabilité et de la sécurisation de la prise en charge du patient....